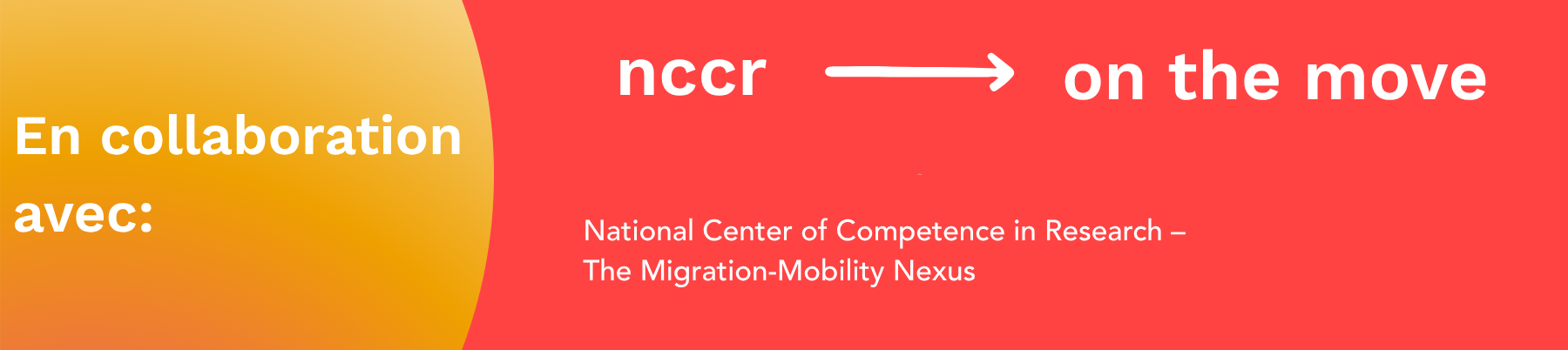Si les normes et les attentes sociales façonnent nos vies à toutes et tous, elles ne s’appliquent pas de la même manière à chacun-e. Une nouvelle étude montre que les migrant-es en Suisse sont soumis-es à des normes plus strictes que le reste de la société, notamment en matière d’engagement social local et de respect de l’ordre juridique. Ce double standard confirme ce que les études sur les migrations ont souligné : seules certaines personnes sont censées s’intégrer, tandis que d’autres ne sont pas soumises aux mêmes attentes.
« Hanna rencontre Sue. Sue lui demande : « Veux-tu venir prendre un café un de ces jours ? » Quelle est la meilleure chose à faire pour Hanna ? (a) convenir d’un moment avec Sue pour prendre un café ; (b) passer quand Hanna a le temps ; ou (c) attendre que Sue invite à nouveau Hanna à venir. » (Orgad 2015)
Vous connaissez peut-être la bonne réponse à cette question, qui a figuré jusqu’à récemment dans l’examen de citoyenneté néerlandais. Peut-être que non. Et peut-être que vous n’avez pas besoin de la connaître. Les citoyen-nes né-es dans le pays sont dispensé-es des examens de citoyenneté et, en général, des attentes en matière d’intégration, telles que celles exprimées dans cette question, de manière plus générale. Ils et elles sont, en quelque sorte, dispensé-es d’intégration (Schinkel 2018) – une critique qui est devenue centrale dans les débats sur l’intégration des migrant·e·s. Mais qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ? Les migrant-es sont-ils et elles soumis·es à des normes sociales plus strictes que les citoyen-nes ?
Le biais migratoire dans les normes sociales
Dans une étude récente, nous avons testé cette idée de manière empirique pour la première fois (Manser-Egli et Lutz 2025). Nous avons posé la question suivante : les migrant-es sont-ils et elles soumis-es à des attentes normatives plus élevées que les autres ? Pour y répondre, nous nous sommes intéressés à la Suisse, un pays axé sur le consensus, avec une société diversifiée et des débats politiques animés sur l’intégration des migrant-es – un contexte similaire à celui des Pays-Bas.
Nous avons interrogé des personnes sur l’importance des normes sociales liées à l’intégration, telles que la participation à la vie du quartier, l’indépendance financière, le respect de la loi et la participation à la vie politique. Pour la moitié des personnes interrogées, les questions faisaient spécifiquement référence aux migrant-es, par exemple «Les étranger-ères devraient avoir des contacts réguliers avec leurs voisin-es », tandis que pour l’autre moitié, elles faisaient référence à l’ensemble de la société, par exemple « On devrait avoir des contacts réguliers avec ses voisin-es ».
En comparant ces deux façons de poser les questions, nous avons pu analyser si les gens ont effectivement des attentes normatives plus élevées à l’égard des migrant-es qu’à l’égard de la société dans son ensemble. Les résultats révèlent que les migrant-es étaient soumis-es à des normes sociales plus strictes que la société en général, notamment en termes d’engagement social local et de respect des lois et des valeurs constitutionnelles. C’est un phénomène que nous appelons le biais migratoire dans les normes sociales.
Un phénomène propre à la Suisse alémanique ?
Il est intéressant de noter que le biais migratoire dépend du contexte, puisqu’il se manifeste dans la partie germanophone de la Suisse, mais pas dans la partie francophone. Cette différence n’est pas seulement un hasard statistique ou le résultat d’un échantillon plus petit, mais reflète une véritable absence de biais migratoire dans la région francophone. Si les deux régions linguistiques affichent un soutien similaire aux normes sociales générales, les attentes à l’égard des migrant-es sont nettement plus fortes dans la partie germanophone.
Cette différence pourrait s’expliquer par la manière dont les deux régions appréhendent la citoyenneté et l’appartenance. La partie germanophone de la Suisse tend vers un modèle d’assimilation de la citoyenneté, fondé sur l’idée d’homogénéité culturelle, auquel les migrant-es doivent se conformer. La partie francophone, en revanche, est plus proche du modèle multiculturaliste fondé sur une conception civique (plutôt qu’ethnique) de la citoyenneté et de la diversité culturelle.
Les cantons francophones ont tendance à adopter des approches plus libérales et inclusives, s’apparentant à la tradition française du droit du sol (citoyenneté basée sur le lieu de naissance), tandis que les cantons germanophones ont tendance à suivre des approches plus restrictives, plus proches du modèle allemand du droit du sang (citoyenneté basée sur l’ascendance). Cela se reflète dans des politiques concrètes : le droit de vote pour les non-citoyen-nes, par exemple, est courant dans la partie francophone de la Suisse, mais largement absent dans la partie germanophone. Plus largement, la région francophone s’aligne davantage sur les valeurs cosmopolites et l’ouverture internationale, tandis que sa contrepartie germanophone penche davantage vers la fermeture nationale.
Imaginaires romantiques de l’intégration
Pourquoi ce biais migratoire dans les normes sociales est-il important et que révèlent les conclusions de notre étude sur la perception publique de l’intégration ? Les politiques envisagent souvent l’intégration en termes locaux et communautaires (voir Anderson 2023), encourageant les migrant-es à rejoindre des associations, à participer à la vie de quartier ou à nouer des liens sociaux. Cependant, nos conclusions suggèrent que le public pourrait romantiser ces imaginaires locaux, imposant aux migrant-es des normes plus élevées qu’aux citoyen-nes.
Pour les citoyen-nes, la participation à la vie locale est en grande partie une question de choix ; pour les migrant-es, il s’agit d’une attente sociale et d’un critère d’intégration. Leur niveau de participation locale est contrôlé et évalué, à la fois en tant que norme sociale et dans la pratique bureaucratique, reflétant la répartition inégale des attentes normatives. Cet écart, que les chercheur-euses appellent « dispense d’intégration », crée un double standard : les citoyen-nes sont épargné-es par les contrôles formels et informels, tandis que les migrant-es sont jugé-es selon des normes plus strictes.
Implications politiques
Le biais migratoire a des implications politiques plus larges. Les mêmes normes sociales s’appliquent-elles à tout le monde ? Le fait que la politique d’intégration cible uniquement les migrant-es ne renforce-t-il pas les divisions qu’elle cherche à combler, au point que la politique elle-même devienne le problème ? Et est-il conforme aux valeurs démocratiques d’exiger des migrant-es qu’ils et elles s’engagent à respecter des normes qui ne sont pas attendues et appliquées de la même manière pour les citoyen-nes (Manser-Egli 2025) ?
Pour en revenir à notre scénario initial, la réponse est simple : (a) convenir d’un moment avec Sue pour prendre un café. En réalité, il n’y a bien sûr pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, et aucune des réponses suggérées n’est particulièrement « néerlandaise » ou « non néerlandaise ». La question est plus complexe : en matière de normes sociales, les migrant-nes ne bénéficient souvent pas de la même marge de manœuvre que les citoyen-nes. Il est essentiel de comprendre ce biais pour respecter les valeurs de liberté et d’égalité dans une société véritablement inclusive.
Références
- Anderson, Bridget. 2023. ‘Integration: A Tale of Two Communities’. Mobilities 18 (4): 606–19.
- Manser-Egli, Stefan. 2025. ‘Illiberal integrationism: shared values as an integration requirement in liberal democracy.‘ Journal of Political Power, 1-20.
- Manser-Egli, Stefan, and Philipp Lutz. 2025. ‘Integration for whom? The migration bias in social norms.‘ European Societies, 1-16.
- Orgad, Liav. 2015. The Cultural Defense of Nations: A Liberal Theory of Majority Rights. Oxford; New York: Oxford University Press.
- Schinkel, Willem. 2018. ‘Against “Immigrant Integration”: For an End to Neocolonial Knowledge Production.’Comparative Migration Studies 6 (31): 1–17.
Image: unsplash.com
Remarque: cette note de blog a été initialement publiée par le the “nccr – on the move” le 6 novembre 2025. Tous droits réservés.